Le Novendécaméron
Effacement(s)
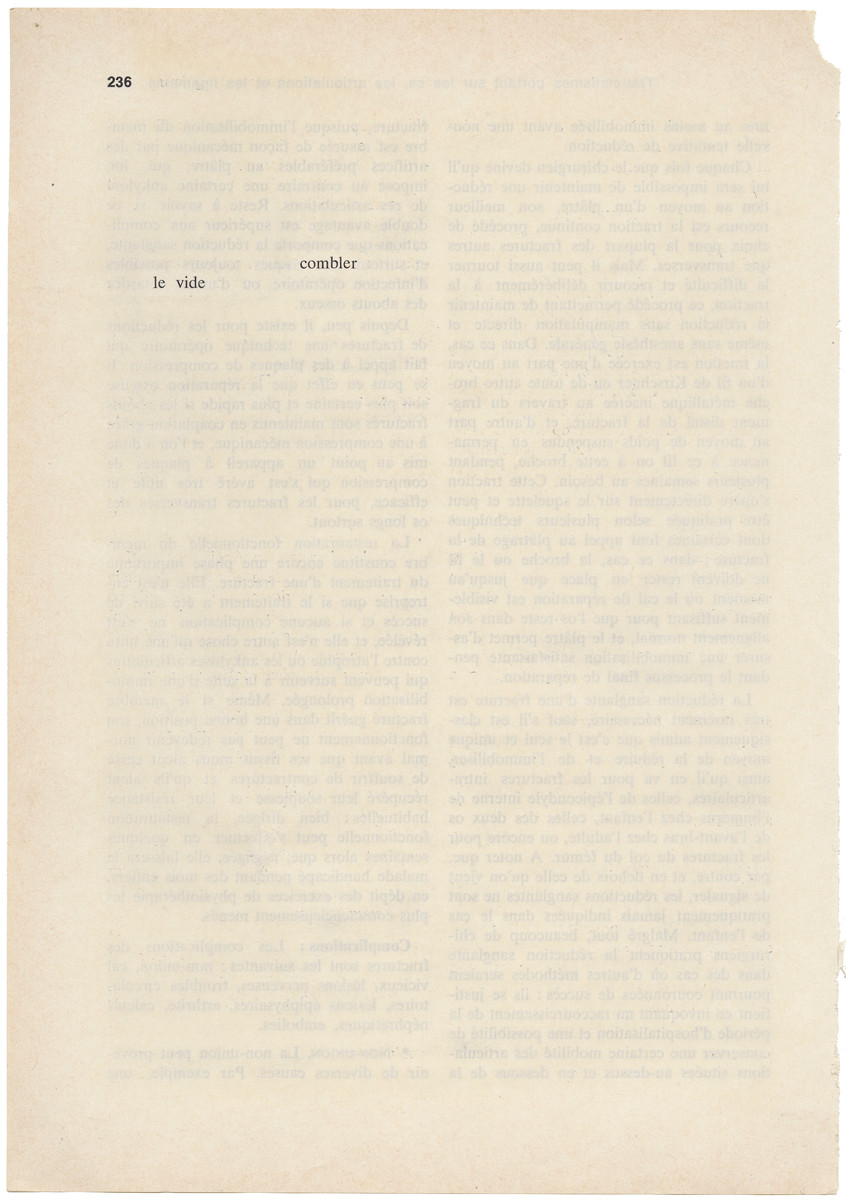
On marche tous les deux le long du couloir interminable. C’est l’été.
Mes mains sont moites. Je suis venue te rejoindre à ton travail. On va repartir ensemble à bicyclette.
Le confinement général dure depuis plusieurs semaines déjà. Et j’opère un retour en arrière de quelques décennies : en fait chaque matin, l’année de mes huit ans revient me hanter.
Cette année-là, j’allais vivre un évènement qui a eu des répercussions sur moi jusqu’à présent.
Son souvenir s’est violemment imposé à moi. J’en avais oublié toute trace. Je suis ahurie de ce que ma mémoire m’a soudainement révélé.
C’est ce lointain évènement qui donne aux conditions de mon confinement actuel un caractère particulièrement toxique. Comme tout un chacun, pandémie oblige, je suis confinée. Je le suis hors de chez moi, chez mon fils et sa petite famille.
Je pense à différentes situations de confinement et sans doute plus difficiles que la mienne.
Celle de ma mère : souvent restée terrée dans sa cave pendant la dernière guerre en France. Elle s’y sentait protégée malgré la crainte d’un effondrement de l’immeuble lors d’un bombardement. Les membres de sa famille étaient réunis autour d’un poêle à charbon, se cuisinaient des galettes à la farine de sarrasin et à l’eau, et se blottissaient les uns contre les autres. Elle m’en parlait avec le sentiment qu’on lui avait volé une partie de sa jeunesse et pourtant il y avait dans ses mots une ondée de tendresse, la tendresse qui les avait fait « tenir » ensemble. Ici la guerre au virus se fait sournoise et la chaleur humaine se fait moins dense face à la superficielle efficacité de nos réseaux sociaux…
Prof depuis des lunes, responsable de classes session après session, prenant la parole de manière convaincante, mère de famille, vaccinée, avec des expériences de vie, de la logique.
Pourtant, quand l’ascenseur ouvre ses portes, je ne peux m’y glisser, j’y fais entrer ma table roulante chargée de livres, j’appuie sur les boutons de chaque étage jusqu’au sixième, l’un après l’autre, un pied dans le couloir, un pied dans l’ascenseur, retenant un long moment la fermeture des portes. Puis je m’éloigne, les portes se referment, l’ascenseur monte, étage après étage avec mon matériel à bord et j’emprunte les escaliers. Je gravis les six étages au pas de course. J’ai bien minuté mon temps, je le maîtrise : je sais combien de secondes mettra l’ascenseur en s’arrêtant à chacun des étages. Au sortir de la cage d’escalier, j’arrive pile au moment où les portes de l’ascenseur s’ouvrent. Devant moi, parfois des profs, des employés qui sortent de la cabine d’ascenseur médusés, tandis que j’extrais mon stock monté sans accompagnement.
Je peux aller marcher. Je peux sortir du condo. Tous les matins, je marche un peu dans le parc. Mais mon fils éprouve une telle crainte d’être contaminé par le virus, lui et sa petite famille, qu’il m’interdit absolument d’entrer dans quelque commerce que ce soit ou de retourner chez moi puisque j’y accueille une colocataire : pas d’épicerie, de marché, de pharmacie, pas de rencontre ou de conversation amicale même à deux mètres de distance. Il craint ne plus pouvoir me revoir si je « prends ces risques ».
Tu travailles dans cet établissement depuis deux ans. Tu en connais les moindres recoins, tu aimes bien me montrer, m’expliquer ce que tu sais. Tu es « l’homme à tout faire » ici : ça va de l’enregistrement des concerts à la maintenance des registres comptables, du transport de matériel à l’aide en cuisine. Le collège est immense, plusieurs bâtiments reliés par des passerelles, des couloirs souterrains : un monde. De l’extérieur, un fier groupe architectural en pierre grise, une toiture argentée, un clocher, des galeries en bois, le tout encerclé d’un parc aux allées ombragées. On y fait de la bicyclette.
Dans ce confinement improvisé, je ne jouis plus du réconfort de mon propre appartement, je ne jouis plus d’aucune intimité. Je n’ai pas de chambre à moi, je vis en communauté serrée autour de deux enfants en bas âge que, oui j’adore, mais mon horaire de vie n’est pas le mien, rien n’est à moi ici, et ces contraintes ralentissent jusqu’à ma capacité de penser, d’écrire, de lire. Je pense à Nancy Huston qui a justement expliqué sa récente panne d’écriture par le fait qu’elle n’était plus chez elle, en France, mais confinée chez son ami en Suisse. Elle remarquait que « si l’écriture se fait dans la solitude, elle ne se fait pas dans le vide »1. Je me sens tout simplement dépossédée de mes propres repères comme je l’ai été ce jour de mes huit ans… Pendant un « certain » temps (je n’en saurai jamais vraiment la durée) qui me sembla infiniment long, mes indices spatio-temporels mais aussi affectifs avaient disparu. Où étais-je ? Pourquoi étais-je abandonnée ?
De ce jour, j’ai probablement associé la perte de repères à l’abandon.
Je n’ai pas été élevée dans du coton, j’ai eu des moments difficiles à traverser comme tout le monde, je ne vis pas dans le luxe et mes besoins sont modestes mais ne pas disposer d’une chambre à moi, ne pas pouvoir saisir tel livre qui m’est cher dans ma bibliothèque, ne pas pouvoir choisir le silence au moment où il me semble indispensable, tous ces manques me renvoient à cette journée de mes huit ans, alors que tout a basculé.
Cette nausée qui m’avait alors prise d’assaut, voilà que je la ressens à nouveau chaque matin du confinement.
Que ce soit sur VIA Rail, Amtrak, dans les trains de la SNCF, sur l’Eurostar, c’est toujours le même scénario qui se rejoue : je risque l’impudeur, je choque les passagers, ceux que je nomme les « intrus ». J’attends toujours de n’en plus pouvoir. Finalement, je ne calcule plus le risque d’être découverte « les culottes à terre ».
Je me dirige vers les toilettes.
Mon envie d’uriner est devenue irrépressible.
Mais je ne vais pas verrouiller la porte. Je ne vais même pas la fermer. Je vais poser mon sac devant pour en bloquer légèrement l’ouverture, la personne voulant entrer se trouvera ainsi retardée dans son mouvement, ce qui me laissera le temps de prévenir : Il y a quelqu’un !
Quel jour sommes-nous ? Je regarde par la fenêtre mais je ne trouve pas non plus d’indice de la saison en cours. En ces temps de confinement, j’évolue dans un temps mou, vague, élastique, sans commencement ni fin prévisible, ni odeur. Un temps qui n’en finit pas de s’étirer. Un temps morbide d’effacement.
Comme j’ai cru être effacée de la carte cette journée où, petite fille, je marchais avec toi Papa.
Cet effacement pourrait-il ouvrir une porte sur une recréation du moi comme les proposent les mises en scène textuelles de l’artiste visuelle Sophie Jodoin ? Cette pensée ne me vient pas par hasard : je travaille présentement sur son œuvre dans le cadre de ma collaboration à une émission radiophonique. Ce qui occupe bien heureusement une parcelle de mon esprit. Les mises en scène textuelles que l’artiste pratique inlassablement interrogent mes propres capacités à faire sens en marquant ce temps vague et sans consistance. En exposant le vide. En le déniant par ces lignes mêmes. Noir sur blanc. Donner consistance au peu qu’il reste. Ce que ce texte tente de faire : la mémoire de l’enfant que j’ai été s’empare des silences, du papier vierge.
Tu es fier de moi, car j’adore t’accompagner dans tes aventures. Tu pars en forêt un dimanche après-midi muni d’un bâton de marche et de ton béret, je te rattrape en courant. Tu montes dans cette barque très abimée pour traverser l’étang, j’y monte aussi. Tu fais bouillir l’huile pour y faire ta brassée de frites, je t’aide à extraire le panier fumant. Maman te prévient : Attention à la Petite ! Tu te moques. Maman n’a pas ton sens de l’humour. Toi, tu blagues souvent. Pourtant les gens disent que tes blagues ne sont pas toujours drôles. Rien ni personne ne m’empêchera de t’accompagner dans tes pérégrinations. Tu aurais voulu un garçon, c’est mal tombé, je suis la troisième fille en ligne. Une fille MAIS courageuse comme un scout répètes-tu, toi qui as longtemps été chef scout.
En ce mois d’avril 2020, je sens mon propre corps se rapetisser, mes os grincer, mon souffle se restreindre.
Dehors n’est plus dehors. Dehors n’est plus synonyme de liberté. Il n’y a plus ces spécificités traditionnelles propres au dehors et au dedans. C’est ici ou là le même enfermement, la même étanchéité, le même manque de liberté, c’est le même souffle difficile.
Dans le travail de S. Jodoin l’absence, l’effacement de certains mots fait ressortir du texte initial un nouveau contenu, un nouveau sens, une nouvelle histoire. Il subsiste un potentiel de message malgré la disparition de la majeure partie des mots contenus dans le texte d’origine. Ainsi, pour l’œuvre il faut qu’elle sache2, le nouveau message est généré par un livre didactique clinique : en ne conservant que certaines bribes de phrases l’artiste tisse une trame fictive et poétique donnant à déchiffrer l’histoire d’une femme. Dans mon cas, le quotidien dans lequel je suis confinée, sans mes « essentiels » sous la main (livres, plumes, encres, papiers de différents types, carnets de notes, photos, collection de dessins d’amis artistes qui forment mon paysage familier), ne m’offre pas une base suffisante pour donner lieu à l’invention d’une nouvelle histoire. Les fragments qu’il me reste ne suffiront pas à donner une nouvelle cohérence à cette vie actuelle. Je n’ai plus d’imagination. Je suis loin de moi. Sinon par cette réminiscence de mes huit ans qui tisse un rapport étroit entre l’actualité et mon enfance.
Les mots qui restent après le fastidieux travail de l’artiste qui a sablé des pages et des pages imprimées ont, par leur nouvelle juxtaposition, configuration, une nouvelle portée. Loin du potentiel de signification dont ils sont issus, S. J. a su identifier la portée des fragments restants. Elle les a mis en scène de manière aussi éloquente que minimaliste sans y adjoindre un seul de ses propres mots. Elle tricote et détricote pleins et vides. En ce qui me concerne, je ne vois plus que les vides et ils ne servent pas même à mettre en relief quelques résidus de contenu.
Marchant dans ce long corridor, tu m’expliques qu’il faut faire beaucoup de provisions dans un tel établissement. Ça prend des placards en tout genre : les balais ici, les vestiaires là, le matériel de nettoyage et puis les bonbonnes de gaz. On ne rencontre personne, c’est l’heure du rassemblement au réfectoire et puis, dans ce secteur du bâtiment, il n’y a pas de chambre, de salon, ce sont les bureaux, fermés à ce moment-ci. Tu t’amuses à produire un écho avec ta voix. Je t’imite. On rit de nos élucubrations. On est complices : à nous deux, on forme une petite équipe. J’aide quand tu répares les vélos, tu affirmes que je sais graisser les chaines mieux que personne. À la maison, j’essuie la vaisselle que tu laves. Tu répètes qu’il faut que je sois habile, courageuse, forte, préparée pour la vie.
Tu es mon modèle.
Tant de marques se sont effacées depuis le début du confinement, tant de repères qui rythmaient la vie quotidienne : prendre le métro, arrêter dans un café, passer à la bibliothèque, dire bonjour aux voisins, acheter mon pain, prendre un verre avec un ami… Effacement d’actions, de déplacements, d’activités qui m’entraine dans un no man’s land. Manque de codes qui semble effacer jusqu’à une partie de moi. Ce qu’il en reste donne forme à une personne incertaine privée de son propre entendement, de sa logique. Une étrangère s’est installée dans mon propre corps. Tels les mots d’un palimpseste dont le sens ne coïncide plus avec le récit originaire dont ils sont issus, comme dans le travail de Sophie J.
Le contenant qui donne forme au contenu s’en est carrément dissocié. Chez moi il ne reste plus que des éléments de contenu épars, non consolidés par le rythme quotidien de mes jours et de mes nuits. Non, décidément, je ne sais pas faire sens de ce qu’il me reste.
Depuis toute petite, tu m’as confié des tâches qui ont affiné mes habiletés : cirer des chaussures, laver un moustiquaire, aller acheter du lait à l’épicerie, retranscrire des adresses sur des enveloppes, classer des journaux par leur date, aller chercher le courrier à la boîte postale. J’avais un rôle dans cette famille, j’allais jusqu’à anticiper les besoins. Mais, dès que tu n’étais plus là, je n’étais plus le « petit scout ». Je me lovais dans un fauteuil avec une bande dessinée, je coloriais dans mes cahiers, je suçais mon pouce, je montais sur les genoux de maman, je réclamais une histoire. J’étais redevenue la Petite.
À l’Hôtel Sofitel de Montpellier, j’ai deux options : soit j’emprunte l’ascenseur que j’actionne avec la clé de ma chambre soit j’emprunte l’escalier dont la lourde porte va se refermer derrière moi sans savoir si je pourrai la rouvrir… Je cogite. Je dois quitter ma chambre et gagner le rez-de-chaussée de l’hôtel. Personne n’attend l’ascenseur. Je choisis la seconde option. J’ouvre la lourde porte de la cage d’escalier. Je la maintiendrai entrebâillée à l’aide d’une revue coincée dans l’ouverture de la porte. Je descends à l’étage qui correspond, me semble-t-il, à la sortie menant au hall d’entrée mais, quand je tente d’ouvrir la porte, impossible. Me voilà prisonnière de cette foutue cage d’escalier. Plus de logique, d’entendement. Je remonte à toute bringue à mon étage. La revue n’a pas été déplacée. Je compose le numéro de la réception. J’explique avoir voulu sortir de la cage d’escalier mais que la porte ne s’ouvrait pas. Vous n’étiez probablement pas à l’étage de la sortie. Cette fois-ci, je m’empare d’un livre à placer dans l’ouverture de la porte. Je m’aventure à nouveau, le cœur battant, dans la cage d’escalier.
Papa et moi, on longe toujours l’interminable couloir. Des fenêtres, sur le côté gauche, des rectangles de soleil qui viennent s’imprimer sur les lattes de bois blond. De grosses portes de métal qui donnent sur le côté droit du couloir. Qu’est-ce que c’est ? Ce sont les congélateurs, me réponds-tu. C’est plein de dindes, de viande.
Aussitôt ces mots prononcés, en un éclair, tu ouvres une des portes et tu me précipites à l’intérieur. Lourd claquement. La porte se referme. Juste le temps d’apercevoir les carcasses de viande. C’est le noir complet.
Papa, Papa !
Impossible d’ouvrir de l’intérieur.
Aucune réponse à mes appels.
Pourquoi ? Pourquoi me terroriser comme ça ? Tu as perdu la tête ? Où es-tu ? Que fais-tu ? Je veux encore crier. Ma voix ne sort pas, je n’ai plus de voix, je tremble, l’urine coule entre mes jambes, je me recroqueville au sol, je fonds en larmes, j’ai la nausée. J’ai fait quelque chose qui t’a déplu ? C’est pas vrai que tu m’aimes ! Tu faisais semblant.
Je ne me souviens plus de la prière que je récite chaque soir, pas d’un seul mot. Je veux maman.
Je vais m’étouffer, je ne peux plus avaler ma salive, je bave.
Cet évènement m’est revenu en mémoire alors que je pensais, en fait, à un autre incident : ce jour où tu as lâché ma main au cœur de Manhattan, un midi de juillet. Je t’ai perdu de vue, le feu est passé au rouge, les piétons m’ont bousculée. Prise de panique, j’ai rebroussé chemin et demandé de l’aide à un épicier avec qui tu avais bavardé quelques minutes plus tôt. Il parlait français. Lorsqu’on s’est retrouvé, tu as lancé : Mais voyons ! Pourquoi tu ne m’as pas suivi ? Tu me fais perdre mon temps !
Je n’ai jamais oublié cet instant de peur et la grande déception qu’a engendrée ta réaction… Il a fallu une pandémie planétaire pour faire sortir le second souvenir plus traumatisant encore… du congélateur !
Je ne saurai jamais combien de temps tu m’as laissée à l’intérieur du congélateur. Tu as ouvert la porte en riant : Tu as eu peur ? Tu sais, tu vas en voir d’autres dans la vie !
Tu avais raison, papa.
Aujourd’hui encore, j’en vois d’autres.
- Direction : Chantal Ringuet et Jean-François Vallée.
- Coordination et direction technique : Antoine Fauchié
- Design et développement : Louis-Olivier Brassard
- Polices de caractères :
- Police de titrage : Cormorant par Christian Thalmann
- Police de corps : Calendas Plus par Raúl García del Pomar et Ismael González (fonderie Atipo)
La publication du Novendécaméron a été rendue possible grâce au soutien du Groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique (GREN), du Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité XVIe-XVIIIe siècles (CIREM 16-18) et du Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT-UQAM).
GREN

CIREM 16-18

CELAT-UQAM

978-2-9820654-1-3
Éditions Ramures
2022 Montréal
Dépôt légal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022