Est-ce génétique de pleurer quand on fait la vaisselle ?*
Coincés entre quatre murs, les souvenirs se nichent dans chaque matière organique chez moi. Pourtant, il n’y a presque aucun objet qui pourrait les faire ressurgir ici, il n’y a pas d’odeur et pas de son qui pourraient y être pour quelque chose. Serait-ce la juxtaposition de mes nombreuses randonnées dans l’appartement, de la montée régulière jusqu’au sommet de la montagne en escalier ou encore du mouvement des rivières calcaires qui descendent lentement vers les profondeurs terrestres par les tuyaux de plomberie, tout comme les glaces qui fondent depuis la haute montagne ?

C’est le printemps, j’ai 12 ans.
Ma mère a pleuré cette nuit, à tel point que je me suis réveillée. Cela lui arrivait souvent depuis que mon père était parti « en voyage », mais cette fois, le bruit semblait dépasser la douce tristesse habituelle. Je me suis levée pour m’approcher d’elle. Elle était assise sur la chaise en bois dans l’entrée de l’appartement sous la lumière habituellement chaleureuse, qui était subitement devenue menaçante. Je lis 18 avril, date indiquée sur une lettre qu’elle avait reçue la veille et déposée sur le meuble du vestibule. Le dos courbé, ses mains se cramponnaient à ses genoux comme si elle devait les consoler ou les réveiller d’une peine inconnue et incurable. Le chat levait la tête devant la porte d’entrée pour se cacher en glissant sous l’escalier. Il nous observait au lieu de se coller aux jambes de ma mère. Elle n’avait pas remarqué ma présence. Le bout des os de ses doigts était blanc en raison de la force de la pression contre ses genoux, et je la voyais dans un état qui précède le vertige, ni assise ni tombée, complètement inerte.
« Maman, qu’est-ce qui se passe ? », lui ai-je demandé. Pause. « Rien de très grave, on va y arriver. Je vais y arriver. Parfois, on pleure. Tout va se remettre en place ». Je savais que je ne pouvais lui poser plus de questions ; que cela allait aggraver le flot de larmes qui traversaient son visage et qui avaient déjà laissé des traces sur sa chemise beige — comme des lacs sur une carte géographique. Cela me rappelait la neige fondante dehors qui se mêlait à la terre jusqu’à faire des mini-rivières dans la rue et sur les chemins. Je redressais ma mère comme je le pouvais et je ne disais rien. Je tenais sa main. Nous sommes restées ainsi pendant un long moment. Le chat s’est finalement assis à nos pieds et nous a regardé avant de poser une patte sur le pied de ma mère et de s’enrouler devant nous — comme ma mère, mais sans pleurer. Quelques mois plus tard, elle allait mieux. J’ai oublié cette nuit pendant longtemps mais, au fond, elle me hantait étrangement, comme une image gravée dans ma tête. Mon père n’est jamais revenu de son voyage.
Des années plus tard, je repense à cette nuit qui est devenue une des énigmes de ma vie, une des zones grises que l’on traîne avec soi comme des fantômes qui se réveillent à des moments apparemment aléatoires et peu chargés d’émotions sur le coup : en se brossant les dents le matin, en pelant les patates ou en attendant à la caisse d’un magasin… en marchant à l’école ou en essayant de faire un mot croisé dans la salle d’attente dans une clinique — comme si les images de cette nuit trouvaient leur place dans la banalité de mes actions, dans les habitudes, les moments de pause imposés. Cette nuit du 18 avril ne tombait pas, elle ne tombait ni dans l’obscurité ni dans l’oubli. Ce que j’ai hérité de ma mère, c’est fort probablement sa capacité à lutter au quotidien, un humour inclassable et une intuition forte pour la vie et les gens, mais elle m’a surtout transmis la même capacité de souffrir, croyant que « souffrir nous rend fortes » — ce qui, en réalité, ne m’a pas toujours apporté beaucoup de joie malgré ma « bonne nature ». Je pleure comme elle, moins souvent, mais j’ai ce regard éternellement ailleurs de la personne qui, malgré sa bonne humeur et son sourire, n’a qu’un seul souhait, celui de réaliser ses rêves.
Je ne sors plus beaucoup, juste pour faire les courses et pour m’occuper du jardin en devenir, car je me sentais un peu malade ces derniers jours. Mon mari me dit que c’est plus prudent ainsi et que c’est mieux pour tout le monde de rester chez soi. Il a oublié que, de toute façon, je ne sortais pas trop et que nous n’avons pas les moyens de voyager beaucoup. Notre appartement, je le connais par cœur depuis toujours et d’autant plus depuis quelques semaines, car je ne le quitte presque plus… Nous y vivons depuis la fin de la guerre. Mon mari a fui sa ville alors qu’elle était occupée par les soldats russes en venant jusqu’ici à pied sans ses parents. Il était encore un enfant. Il les a tous fait venir dans les années 1950, sa tante, son oncle et leurs petits, sauf ses parents qui ne voulaient pas partir. Depuis, il a affiché leur photo dans la cuisine, chaque jour ils nous regardent depuis leur maison et ils m’observent.

On vivait à presque dix personnes dans cet appartement avec ma fille qui a vu le jour en 1953. On habitait au premier étage d’un immeuble de trois appartements où il y avait une cave. Un petit chemin et des escaliers fabriqués en minuscules pierres brunes conduisent à la porte d’entrée commune. Elle est faite bizarrement : des pierres bleues et grises coupées en tranches et gravées sous une paroi de verre transparent. Je me suis toujours dit que cela ressemble à des poissons qui ne peuvent plus nager ou encore à des trouvailles archéologiques jamais identifiées. La porte d’entrée de notre appartement est en bois, rien de spécial. Il n’y a pas de chaise dans le couloir. En entrant, tout de suite à la droite, il y a la chambre à coucher, petite, mais confortable. Du plancher flottant en bois clair, un grand lit avec des draps — la plupart du temps, ils sont beiges — et des armoires et des étagères en hêtre. De quoi se réjouir quand on aime les couleurs. Il y a des photos de famille sur la commode qui — elle aussi — est en hêtre. Une rose rouge en plastique dont on peut allumer l’une des feuilles pour qu’elle joue « Lettre à Élise » décore le reste. Un cadeau romantique. Les rideaux sont blancs et touffus. L’odeur qui se répand dans la pièce est celle d’un couple qui lave assez souvent ses draps et qui dort les fenêtres ouvertes. En marchant le long du couloir, on arrive à la pièce suivante à droite, celle de mon fils qui a quitté la maison depuis longtemps. Il y a encore ses posters au mur, notamment des affiches de joueurs de soccer et de hockey et les médailles gagnées au fil du temps sur la patinoire de l’aréna qui a fermé depuis. Je n’ai rien touché en attendant qu’il manifeste le souhait de les enlever un jour — ce que j’espère. Tout est en bois, mais en bois vert : un lit simple, un bureau, une armoire et des étagères. Depuis son départ, comme on ne chauffe pas cette pièce l’hiver, je dépose les gâteaux de Noël que je fais dans des boîtes sous son lit. J’en fais au moins quinze boîtes — environ 300 pièces — afin de les emporter chez ma fille le 24 décembre pour en donner à tout le monde. Dans l’armoire de cette chambre, je cache aussi du chocolat pour nos petits-enfants et, de temps en temps, un billet de banque. Mon mari leur donne de l’argent parfois, mais pas assez. Alors, c’est un jeu de cache-cache… je lui pique un billet en cachette, je le cache et je le donne — à nouveau en cachette — à nos petits-enfants qui le cachent dans leur poche, à la fois gênés et contents.

Passons au salon. On y trouve une porte patio toute petite qui donne sur un balcon. J’y coupe souvent les haricots du jardin. Dans la pièce, il y a une table où mon mari joue aux cartes avec ses amis, mais on l’agrandit aussi le 25 décembre ou lors des anniversaires. Je cuisine habituellement trop de tartes et de gâteaux. C’est une table — en bois, encore une fois — de couleur jaunâtre, avec des coussins beiges sur les chaises. Elle en a entendu des histoires; et elle en a senti, des coudes collés sur elle comme les feuilles d’automne sur l’asphalte après une grande pluie ; la radio que mon mari apporte dans le jardin de temps en temps y est posée comme une statue fixe. Il faut surtout lui laisser sa chaîne de radio à lui — je la trouve particulièrement plate. Il y a aussi un calendrier au mur (celui qu’une association de bienfaisance nous envoie chaque année) et un baromètre (en bois et beige, sans surprise) que mon mari consulte quand son genou lui fait mal. « La météo va changer ». Pourtant, mon petit doigt qui fait mal avant la pluie est plus précis en général que son genou. Sinon, il y a une très grande armoire dans le salon, avec quelques livres que je n’ai jamais lus parce que je préfère regarder la télévision — et comme j’ai quitté l’école à 14 ans, j’ai un peu de mal à me concentrer et à lire correctement. Alors, assise dans le fauteuil du coin qui est proche de la fenêtre numéro 1, je feuillette des magazines sur la cuisine, les diètes (que je ne fais pas) et les maisons royales. Il y a aussi un grand canapé qui longe le mur en face de l’armoire et une petite table dans le coin avec un téléphone fixe. On ne s’en sert pas souvent. Hormis ma fille, mon fils et mon frère, peu de gens appellent. Et quand je les ai au téléphone, mon mari est presque toujours dans le coin pour écouter ce que je dis et pour faire des commentaires à voix haute… Le fil n’est pas assez long pour quitter la pièce. Quel bonheur ce serait que le fil du téléphone ou ce soi-disant super téléphone fixe sans fil (que nous ne pouvons pas acheter) puisse se rendre jusqu’au fond du jardin pour que je passe mes coups de fil en paix ! J’aurais un peu d’intimité, de liberté. Il parait aussi que maintenant, il y a des appareils qui ressemblent à de petites télévisions et avec lesquelles on envoie des messages à distance. Cela doit être amusant, un peu comme le télétexte, je pense.
Sur le bord des fenêtres, il y a des plantes et les orchidées, surtout des orchidées mauves. Je les arrose rarement et juste avec un petit verre de digestif dans lequel je mets l’eau — pas d’alcool, on s’entend. Avec le jardin, l’endroit où je passe le plus clair de mon temps est la cuisine — comme beaucoup de femmes de mon âge — je le sais bien. Elle est petite, mais fonctionnelle. En entrant, il y a une étagère encastrée à gauche. J’y ai déposé des photos de ma petite fille à côté de celles de mes beaux-parents. Sur une des photos, elle vient de faire ses premiers pas et sur l’autre, elle est en voyage en Angleterre pour ses 16 ans. J’ai peu voyagé et je n’ai jamais quitté l’Europe, mais ma fille et mon fils (ils ont 15 ans de différence) m’ont montré des lieux fantastiques en photos et, si je le pouvais, je voyagerais encore et encore avec eux et leurs images imprimées. Mais ce sont surtout leurs histoires qui me manquent. Dans la cuisine, il y a une petite table ronde avec deux chaises, mais c’est serré. Une étroite fenêtre donne sur l’arrière-cour, sinon il y a un lavabo, un four et des armoires, un plan de travail. Une cuisine classique, en bois évidemment.
Aujourd’hui, je prépare les patates. Mon mari est toujours derrière mon dos pour surveiller la cuisson, mais aujourd’hui je suis tranquille, car il coupe du bois dans l’établi au fond du jardin. J’aime couper et préparer les patates, car je peux regarder dehors et la cuisine est mon propre espace. En haut à gauche, sur la table, je pose toujours la casserole remplie d’eau, puis j’enlève la peau des patates soigneusement, ensuite je les lave. Quelques traces brunes restent sur le jaune, ce n’est pas gênant et je dépose les patates coupées en deux la plupart du temps dans la casserole. En général, je prépare au moins trois patates par personne, mais nous sommes surtout en duo, ces temps-ci. Avant, ma fille et mes petits-enfants venaient manger après l’école, mais ce n’est plus le cas. Ils sont grands maintenant et je crois qu’ils me trouvent ennuyante — c’est normal — moi aussi, je me trouve ennuyante — disons que je suis ennuyée. Je m’observe souvent en train de peler lentement, six patates, ça va vite, si vite. Je n’aime pas faire la vaisselle. Ma mère versait souvent des larmes en silence dans l’eau ou encore, elle les cachait simplement avec un torchon de cuisine quand quelqu’un rentrait et elle tournait le dos ; le lavabo donnait contre le mur sans fenêtre.
Est-ce génétique de pleurer quand on fait la vaisselle ? Qu’ai-je hérité de mon père ? Probablement tout le reste, quelques souvenirs vagues et la lettre datée du 18 avril qu’il a adressée à ma mère ; une lettre que j’ai pu lire pour la première fois il y a deux ans, juste avant sa mort. Une lettre dans laquelle on lui annonce que mon père est tombé au front en Russie pour défendre la soi-disant patrie.
Moi aussi, je pleure parfois en cachette quand je fais la vaisselle. Une fois, ma petite-fille m’a vue et elle m’a demandé pourquoi. Je ne lui ai pas répondu, car je n’ai pas de réponse — « Je rajoute de l’eau magique, car ça nettoie mieux les plats », lui ai-je dit — et elle riait tellement que l’on aurait pu croire que l’appartement allait exploser – puis, moi aussi, je me suis mise à rire avec elle.
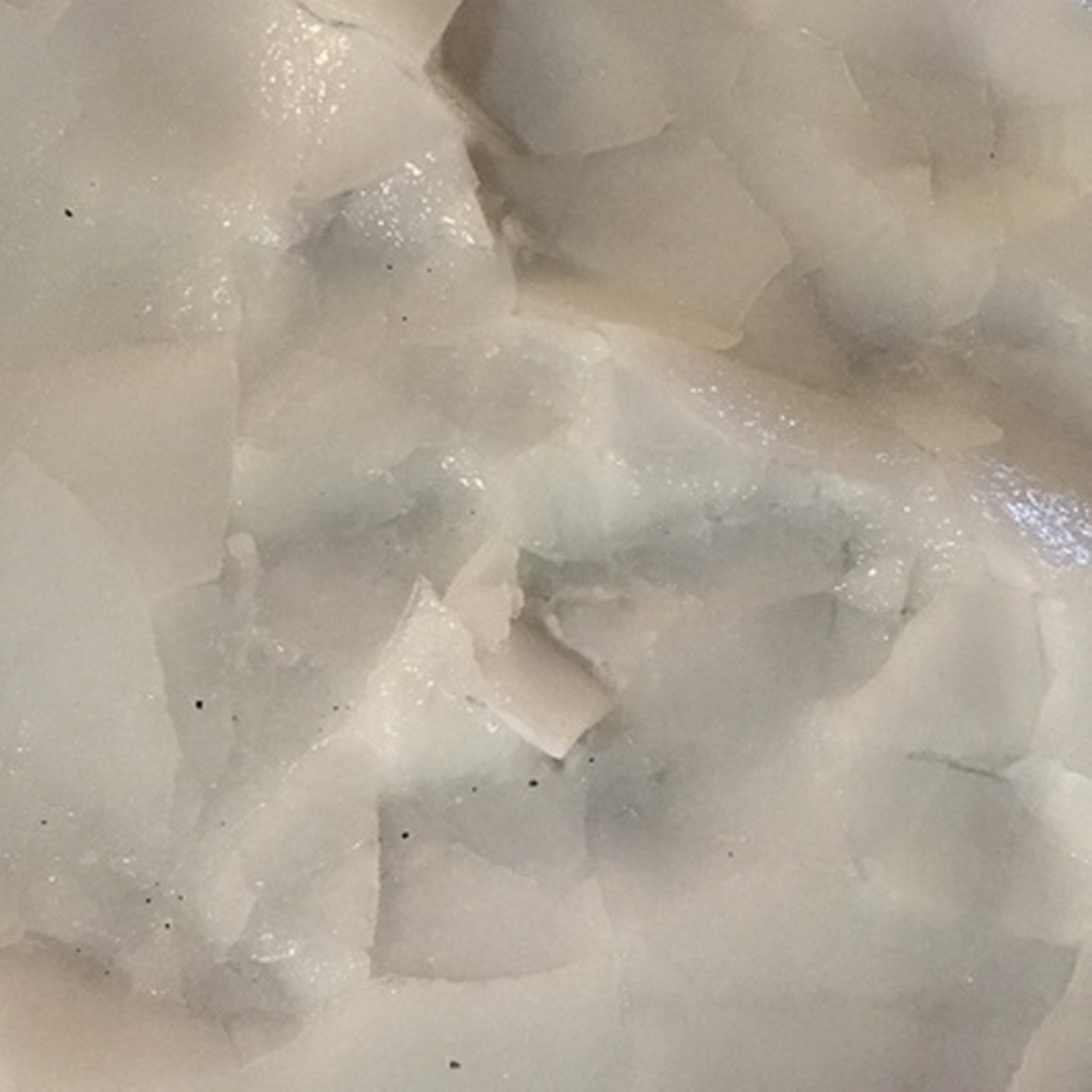
Joignez-vous à la conversation sur les œuvres du Novendécaméron
Nous souhaitons créer une communauté de dialogue autour des œuvres du Novendécaméron. Certaines réactions, questions ou réflexions que vous déposerez ici pourraient donc être publiées ensuite sur ce site ou dans le recueil numérique qui paraîtra au terme de cette aventure littéraire et artistique.
Merci d’avance pour vos contributions !